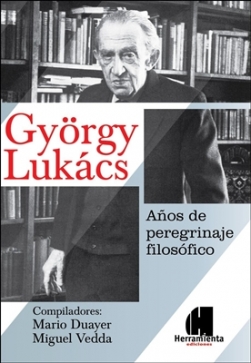ENTRE « COMPROMIS HISTORIQUE » ET TERRORISME Retour sur l’Italie des années 70
Toni Negri
EX-DIRIGEANT historique du groupe Pouvoir ouvrier, l’équivalent italien de la Gauche prolétarienne (maoïste), Antonio (dit Toni) Negri est actuellement incarcéré à la maison d’arrêt Rebibbia, à Rome. Décidé à mettre un terme à son « histoire judiciaire » et à celle des militants d’extrême gauche encore poursuivis, il s’est livré, le 1er juillet 1997, après quatorze ans d’exil à Paris. Condamné à trente ans de prison pour « insurrection armée contre l’Etat » et à quatre ans et demi pour « responsabilité morale » des affrontements entre militants et police à Milan entre 1973 et 1977, il lui reste théoriquement – compte tenu du temps passé en détention préventive et des remises de peine – plus de quatre ans à purger. En attendant l’ indulto (remise de peine) général que les parlementaires italiens se refusent jusqu’ici à voter, Toni Negri a été autorisé, fin juillet, à travailler à l’extérieur. Il évoque ici l’expérience politique des années 70 en Italie.
Parler des années 70 dans l’histoire italienne, c’est parler du présent. Non seulement parce que les conséquences des politiques répressives d’alors perdurent – les lois spéciales n’ont pas été abrogées, deux cents personnes au moins sont encore incarcérées et autant en exil (1). Non seulement parce que la désagrégation du système politique d’après-guerre, réduit en miettes par la chute du mur de Berlin, avait atteint des limites insoutenables. Mais aussi, et surtout, parce que le traumatisme social (et psychologique) de cette décennie n’a encore été ni refoulé ni cicatrisé.
Les années 70 sont présentes parce qu’elles ont posé à l’Italie le problème de la représentation démocratique dans la transformation des modes sociaux de production, ce noeud central des sociétés capitalistes avancées qui n’est pas encore dénoué. En Italie, la présentation de ce noeud de problèmes a pris à ce moment-là une tournure tragique.
Toutes les forces politiques impliquées dans ce drame ont été vaincues. Deux auteurs, plus que d’autres, ont témoigné sur cette tragédie radicale : d’un côté Leonardo Sciascia (2), de l’autre Rossana Rossanda (3). Le premier assurait la chronique des événements en soulignant combien la crise tenait du labyrinthe, la seconde relatait chaque jour, sans jamais se désengager, l’impuissance désespérée des protagonistes à trouver une issue.
En Italie, les années 70 commencent, en fait, en 1967-1968 et se terminent en 1983. En 1967-1968 le mouvement étudiant, comme dans tous les pays développés, érigea des barricades. Pourtant, son envergure et son impact n’eurent pas la même ampleur que dans les autres pays européens : en Italie, le mai 68 étudiant proprement dit fut faible.
Mais il n’en va pas de même si on le juge d’un point de vue plus général : il a en effet ouvert, dans le système du pouvoir, une brèche dans laquelle s’est engouffrée, en vagues successives, la protestation sociale contre un système qui accumulait les retards dans la modernisation du capitalisme et réprimait le potentiel démocratique hérité de la lutte antifasciste et de la Résistance.
C’est ainsi qu’après les étudiants d’autres acteurs sociaux se sont imposés sur la scène politique. Par exemple, 1969 est l’année ouvrière des nouveaux conseils d’entreprise (consigli di fabbrica), de l’égalitarisme dans les augmentations de salaire, du dérèglement des politiques capitalistes en matière de marché du travail. Le statut des travailleurs (statuto dei lavoratori) couronne cette phase des luttes. Viendront l’organisation des pouvoirs des régions, l’introduction du divorce, l’objection de conscience, sans parler de nombreuses innovations législatives qui ont « décongelé » la vieille société de l’après-guerre. Autant de réponses institutionnelles à un enchaînement continu de luttes – pas seulement étudiantes, ni même ouvrières – ouvert par 1968.
La « stratégie de la tension »
VERS 1973-1974, le cadre se modifie. Jusqu’à ce moment-là, la relation entre les mouvements sociaux et la « gauche » avait été, malgré des accidents de parcours, essentiellement dialectique. Après la crise du pétrole de 1973 et les premières contre-offensives capitalistes, les choses changent. La gauche italienne interrompt le dialogue avec les nouvelles forces sociales, et sa composante majoritaire, le Parti communiste italien (PCI), propose un « compromis historique » (compromesso storico) à l’adversaire de toujours, la Démocratie chrétienne (DC).
Or le système politique italien, il faut le rappeler, était alors caractérisé, pour des raisons liées à la position du pays dans le scénario de la « guerre froide » (4), par son « bipartisme imparfait ». Autrement dit, dans la norme de la vie parlementaire existait une convention ad excludendum concernant le PCI : quelle que fût sa force électorale, le parti d’Enrico Berlinguer (5) était exclu du pouvoir, censé rester entre les mains de la Démocratie chrétienne, rempart de l’Occident. Malgré cette contrainte institutionnelle, les deux forces avaient imaginé un système de pouvoir permettant un certain équilibre, espérant ainsi modérer les conflits sociaux lorsque ceux-ci débordaient. A côté d’un « bipartisme imparfait » existait donc ce qu’on appelait un « coassociativisme imparfait ».
Au début des années 70, s’appuyant sur la force électorale croissante que lui offre le développement des mouvements sociaux, le PCI décide de participer plus en profondeur à la majorité. Il ne se présente plus seulement comme un « parti de lutte », mais comme un « parti de lutte et de gouvernement ». Du coup, à partir de 1973-1974, le Parlement va travailler dans une unanimité de fait. En 1978, le PCI ira jusqu’à appuyer le nouveau gouvernement. Ce faisant, il démissionnera des dernières fonctions de contrôle qui lui étaient imparties, dans le « bipartisme imparfait », en tant que représentant de l’opposition. Le « coassociativisme » devenait « parfait ».
Les années 1974 à 1978 voient s’approfondir progressivement l’alliance entre DC et PCI : du gouvernement et du Parlement, celle-ci s’étend à tout le système de pouvoir, de l’administration centrale à la périphérie, aux syndicats, à la gestion des moyens de communication et, dulcis in fundo, à la police. Simultanément, les luttes s’accentuent et les mouvements sociaux rompent définitivement avec toute représentation institutionnelle. N’oublions pas qu’il s’agissait de batailles de très grande envergure et d’énorme intensité.
Car, au-delà du simple exercice de ce « contre-pouvoir » qu’ils incarnaient depuis 1968, les mouvements sociaux étaient alimentés par les conséquences des politiques de déflation monétaire et de restructuration industrielle par lesquelles s’organisait une première – mais décisive – « sortie du fordisme » du système productif italien. Or le « compromis historique » s’était justement bâti autour de ces « politiques d’austérité » contre lesquelles se dressait la mobilisation sociale.
Ainsi, quand la répression – celle du patronat dans les usines et celle de la police, bénéficiant d’un nouvel arsenal législatif, dans la société – passa les bornes démocratiques, la résistance en vint à son tour à s’armer. C’est surtout parmi les ouvriers des grandes usines du Nord, sauvagement restructurées, que les Brigades rouges (6) commencèrent à s’organiser ; et c’est dans ces mêmes usines, ou dans les zones limitrophes, qu’apparurent des pratiques de « justice prolétarienne », tantôt de masse, tantôt clandestines.
A cet enchevêtrement de composantes sociales et politiques, désormais traversé par une série ininterrompue de luttes ouvrières et de violences urbaines, s’ajoute une variable indépendante et surdéterminée. C’est la provocation directe – comment l’appeler, sinon « terroriste » ? – des organes de l’Etat en charge des obligations de la « défense atlantique », avant, pendant et après le « compromis historique ».
A partir du massacre de Milan en 1969, ces appareils ne cessent, année après année, d’accroître leur intervention, des bombes lancées pendant les défilés et les meetings populaires, dans les gares et dans les trains, jusqu’à l’horrible tuerie de Bologne en 1980 (7) (actuellement, aucun des responsables et des commanditaires de ces massacres n’est incarcéré). Ces actions criminelles ont évidemment jeté de l’huile sur le feu d’une résistance qui ne demandait qu’à s’exprimer et en avait les moyens.
En 1977, le mouvement connaît une soudaine et très forte flambée, à partir de Bologne, la ville-vitrine de la politique urbaine du PCI. A l’issue d’une manifestation, un énième militant y est tué par la police. Une émeute éclate. Le maire communiste et le gouvernement de « compromis historique » envoient les chars balayer les barricades. A la même période, le secrétaire national du syndicat communiste est expulsé de l’université de Rome, après de très violents accrochages, par un mouvement étudiant de masse qui s’élargit désormais au prolétariat urbain.
A Milan, Turin, Naples, Padoue défilent d’énormes cortèges dans lesquels, de plus en plus fréquemment, apparaissent des groupes extrémistes armés, qui s’affirment comme une des composantes du mouvement. La résistance ouvrière et les mouvements prolétariens urbains contre les restructurations grandissent irrésistiblement dans la rancune à l’égard de la trahison de la gauche. S’ensuit une quasi-guerre civile qu’aucun des acteurs ne contrôle plus. Cette tragédie va se terminer par une défaite. Pour tout le monde.
Les premiers vaincus sont les mouvement sociaux. Totalement coupés des représentants de la gauche traditionnelle, incapables de donner une forme politique adéquate à l’expression du contre-pouvoir et de contrôler celui-ci, ils seront entraînés dans le gouffre d’un extrémisme toujours plus aveugle et violent. L’enlèvement et l’assassinat d’Aldo Moro (8) représenteront l’apogée d’un mouvement qui, mettant en avant ses objectifs militaires, avait perdu la capacité de mesurer les conséquences politiques de ses actions. Prise dans cet étau, la mouvance politique qui avait structuré les aspirations de centaines de milliers d’agitateurs et de militants sera bientôt dissoute par une répression massive et puissante.
Les forces politiques porteuses du « compromis historique » ont cherché, elles aussi, à sortir de l’isolement social dans lequel elles étaient tombées, mais par une politique de répression pure et simple. Elles gagnèrent, mais ce fut une victoire à la Pyrrhus. Polices spéciales, prisons spéciales, tribunaux et procès spéciaux, activité spéciale de gouvernement : l’« urgence » a remodelé, tout en l’isolant encore plus, la structure constitutionnelle d’un système politique déjà massacré par le « bipartisme imparfait ».
Avec des conséquences dramatiques, et d’abord pour le PCI, qui, à partir de ces années-là, sera à la merci de la droite, enregistrant une baisse continue de ses suffrages et échouant à rétablir le moindre contact avec des mouvements sociaux, d’ailleurs marginalisés. Le Parti communiste va devenir ce que jamais, dans son histoire originale et glorieuse, il n’avait été : un groupe bureaucratique cantonné à l’intérieur de la machine du pouvoir et à l’extérieur à la société. Pour sa part, la Démocratie chrétienne a perdu au cours de ces événements sa position constitutionnelle centrale : elle s’enfermera dans la gestion de son pouvoir local et n’arrivera plus à se donner les instruments nécessaires à la compréhension du paysage productif et social au sein duquel la crise était née. C’est au gouvernement Bettino Craxi (socialiste), mis en place en 1983, qu’incombera la tâche de transformer l’isolement de la classe politique en une énorme machine de corruption et de dégradation de la société et de l’Etat. Les années 70 étaient finies.
Auraient-elles pu déboucher sur une issue différente dans la situation politique et à l’intérieur du système politique de l’époque ? Oui, à une seule condition : qu’ait existé à ce moment- là un mode de représentation politique à même d’absorber les conséquences des très profondes mutations sociales que les mouvements imposaient. Ce ne fut pas le cas alors, et ensuite le problème ne s’est plus posé.
Après la chute du Mur et la reconstruction radicale du cadre politique et parlementaire, les seules tendances esquissées en Italie – sans jamais parvenir à se réaliser, comme vient de le confirmer l’échec du projet de réforme constitutionnelle élaboré par la commission bicamérale (9) – se sont concentrées sur le sommet (système présidentiel) et, en conséquence, sur la mise en place d’instruments toujours plus efficaces et centralisés de prévention, de médiation et de répression. Pas une proposition de nouvelles formes de représentation politique, ou de nouvelles articulations pour une démocratie substantielle. Quant à l’activité gouvernementale, dans la réalité actuelle de la Seconde République, elle se consacre pour l’essentiel à la neutralisation de tout conflit et au contrôle de la compatibilité du système avec le « marché mondial ».
La défaite des mouvements des années 70 – défaite politique (comme dans d’autres pays européens) ou militaire (comme en Italie) – n’a pas débouché sur le moindre espoir de rénovation de la démocratie. Ceux qui y ont participé peuvent, certes, pleurer sur leur propre naïveté tactique et se désespérer de leurs illusions stratégiques. Mais ils pourront toujours ajouter : le problème que nous représentions existe toujours. L’Italie d’aujourd’hui a plus que jamais besoin de redécouvrir les vertus démocratiques expérimentées alors.
(*)Par TONI NEGRI
Auteur, entre autres, de La Classe ouvrière contr e l’Etat, Galilée, Paris, 1978, et d’ Italie rouge et noire, Hachette, Paris, 1985, Toni Negri a été chargé de cours à l’Ecole normale supérieure de la rue d’Ulm et enseignant à l’université Paris-VIII, ainsi qu’au Collège international de philosophie.
NOTES
(1)
Lire Anne Schimel, « Justice de plomb en Italie », Le Monde diplomatique, avril 1998. Toutes les notes de cet article – comme le surtitre, le titre et l’intertitre – sont de la rédaction.
(2)
Ecrivain, chroniqueur et journaliste, Leonardo Sciascia (1921-1989) a observé l’Italie depuis sa Sicile natale ; il est, entre autres, auteur des romans A chacun son dû (1966) et Todo Modo (1974), disponibles chez Gallimard.
(3)
Rossana Rossanda a fondé, avec Luigi Pintor, le quotidien romain Il Manifesto, qu’elle dirige encore aujourd’hui.
(4)
Lire François Vitrani, « L’Italie, un Etat de »souveraineté limitée« ? », Le Monde diplomatique, décembre 1990.
(5)
Enrico Berlinguer fut, après Palmiro Togliatti et Luigi Longo, le troisième secrétaire général du PCI de l’après-guerre. Il a notamment proposé, après le putsch du général Pinochet au Chili, le « compromis historique » (1973) et défini, à l’échelle du Vieux Continent, un projet « eurocommuniste », opposé à celui de Moscou.
(6)
Les Brigate Rosse (Brigades rouges) étaient, comme Prima Linea (Première ligne, 1976-1980), un des groupes militaires de l’extrême gauche – dans laquelle on comptait également, mais agissant sur le seul plan politique, Lotta Continua (Lutte continue, 1969-1976), Potere Operaio (Pouvoir ouvrier, 1969-1973), etc.
(7)
L’explosion d’une bombe dans la Banque de l’agriculture, piazza Fontana, à Milan, le 12 décembre 1969 (16 morts et 98 blessés), marque le début de la « stratégie de la tension », laquelle culminera avec l’attentat à la gare centrale de Bologne, le 2 août 1980 (85 morts et 200 blessés). Dans les deux cas, comme la justice l’a confirmé plus tard, c’est l’extrême droite qui était l’instrument de ce terrorisme aveugle. Selon les statistiques du ministère italien de l’intérieur, 67,55 % des violences (rixes, actions de guérilla, destruction de biens) commises en Italie de 1969 à 1980 sont imputables à l’extrême droite, 26,5 % à l’extrême gauche, et 5,95 % à d’autres.
(8)
Au moment de son enlèvement, le 16 mars 1978, Aldo Moro, président de la Démocratie chrétienne, négociait avec Enrico Berlinguer les possibles modalités d’une association du PCI au gouvernement.
(9)
Présidée par M. Massimo D’Alema, numéro un des Démocrates de gauche (DS, ex-PDS, ex-PCI), la commission bicamérale avait pour but la négociation d’un projet de réforme constitutionnelle portant, entre autres, sur l’élection du président de la République au suffrage universel et la modification du mode de scrutin dans un sens majoritaire. Ses travaux ont pris fin en mai 1998 après la volte-face de M. Silvio Berlusconi, chef de Forza Italia, qui avait, un temps, accepté le projet.
©EspaiMarx 2002