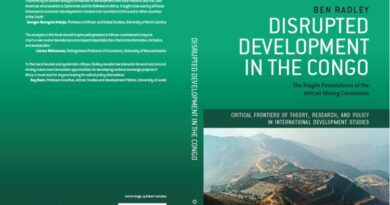Antonio Negri et le pouvoir constituant
Daniel Bensaid
La taupe est hémophile. Le moment d’apparaître est pour elle l’heure de tous les dangers. Il arrive en effet qu’une main cruelle ait glissé dans sa taupinière des lames de rasoir ou du verre pilé. Elle se vide alors de son sang, sa laborieuse vie en mort s’échappant.
Dans une note de la Fondation Saint-Simon, Philippe Raynaud range Antonio Negri et Alain Badiou sous la commune bannière de la “ passion révolutionnaire ”[1]. Sans doute cette passion est-elle partagée. Mais la question démocratique, que Badiou ignore superbement, est chez Negri au cœur du débat: “ Parler de pouvoir constituant, c’est parler de la démocratie ”, écrit-il dès les premières lignes de son livre[2]. Dans la mesure où elle déploie une temporalité spécifique, la “ liberté constituante ” excède la vérité éphémère de l’événement. Le pouvoir constituant se réalise en “ révolution permanente ” et cette permanence conceptualise l’unité contradictoire de l’événement et de l’histoire, du constituant et du constitué.
Parler de pouvoir constituant, c’est parler de révolution, et réciproquement. Il représente “ la dilatation de la capacité humaine à faire l’histoire ” au lieu de la subir. Negri en appelle à Spinoza comme le premier penseur de ce pouvoir illimité, ou plutôt de cette “ puissance ” (potentia) irréductible à l’exercice du pouvoir (potestas), fût-il éclairé. Le Dieu de Spinoza, précise Deleuze, “ ne conçoit pas des possibles dans son entendement qu’il réaliserait par sa volonté ” : “ Aussi n’a-t-il pas de pouvoir, mais seulement une puissance identique à son essence. Suivant cette puissance, Dieu est également cause de toutes choses qui suivent de son essence, et “ cause de soi-même ”, “ de son existence telle qu’elle est enveloppée par l’essence ”. Toute puissance est donc “ acte, active, et en acte ”[3].
Il en va de même du pouvoir constituant. Comme tout état de puissance, il est toujours en acte. Il ne se conçoit pas comme un possible qui s’actualise, mais, à la manière du conatus de Spinoza, comme effort et tendance de l’essence à persévérer dans l’existence et à envelopper “ une durée indéfinie ”. Sa puissance expansive est une passion joyeuse. Et cette joie entretient et augmente en retour la puissance d’agir.
La Commune de Paris, dont “ la grande mesure sociale ” fut, selon Marx, “ sa propre existence ”, en est la parfaite illustration. L’exercice de ce pouvoir illimité pousse logiquement l’élan démocratique jusqu’au dépérissement de l’Etat en tant que corps politique séparé (et réciproquement, de l’économie conçue comme seconde nature). Cette extinction d’un appareil étatique spécialisé, opposé à la société, ne saurait se confondre avec la disparition de la politique. Pour Negri, ce sont la pensée libérale et la pensée anarchiste qui représentent “ les figures les plus achevées de la rationalité instrumentale ”. Dans l’un et l’autre cas, “ le social n’a pas besoin du politique ” : “ La main invisible du marché comme la négation abstraite de l’Etat nient le pouvoir constituant. Que ces visions de la société reposent sur l’individualisme et sur la règle du profit, ou sur l’anarchie et sur la règle du collectivisme, il s’agit, dans un cas comme dans l’autre, d’isoler le social, et cette fin est le pendant nécessaire de la transcendance du politique, invoquée d’un côté et honnie de l’autre[4]. ” Chaque crise, dans la mesure où elle bouleverse le champ politique, claque donc “ comme un avis de décès des théories de la séparation ”.
A la dissociation illusoire du politique et du social, Negri oppose une dialectique de la puissance et du pouvoir, un double processus de politisation du social et de socialisation de la politique. Inaliénable, “ la liberté constituante ” manifeste la résistance de la puissance fondatrice à la rigidité pétrifiée de l’institution. La “ production du sujet constituant ” est selon lui au centre des trois Déclarations des Droits de l’Homme (de 1789, 1793, et 1795). Le sujet émergent s’y constitue dans un conflit permanent avec la propriété privée et avec la raison d’Etat qui s’efforcent de le contenir et de le refouler. La clôture nationale (la victoire de l’Etat-nation sur l’universalité proclamée), sociale (la répression du mouvement populaire), et sexuelle (la mise au pas des tricoteuses et l’exclusion des femmes) du moment révolutionnaire, scelle la défaite et condamne la conjuration permanente au repli dans les catacombes de l’histoire. Jusqu’aux nouvelles irruptions de 1830 et 1848.
La liberté politique se définit donc comme “ pouvoir constituant ”. Mais constituant de quoi ? Le “ fantastique ” et le “ merveilleux ” caractérisent chez Rousseau les situations exceptionnelles, où se manifeste l’insolite et où surgit la nouveauté. Le pouvoir constituant dont le capitalisme moderne “ mène, dit Negri, le concept à sa maturité ”, en est l’exemple[5]. Il n’est désormais “ de définition du politique, qu’à partir du concept de pouvoir constituant ” qui en détermine désormais la nature et la substance[6]. Car la puissance constituante ne vient pas après la politique. Elle n’en est pas le résultat ou la conséquence. Elle “ vient d’abord ”, et s’impose comme “ la définition même de la politique ”. Sa répression réduit la politique à un pouvoir despotique ; non nécessairement sous les traits avoués de la tyrannie, mais plus sournoisement, sous ceux d’un despotisme banal et quotidien, que Jacques Rancière désigne comme “ police ” et Alain Badiou comme “ Etat antipolitique ”. Tendu à l’extrême, l’arc démocratique du pouvoir constituant peut alors, par un retournement paradoxal, se renier dans l’affirmation opposée d’une vérité sans discussion et d’une subjectivité sans opposition[7].
Face au pouvoir institué et tyrannique du capital, face aux fétiches de la marchandise et aux servitudes involontaires qu’ils imposent, face au triomphe du travail mort qui saisit et assujettit le vif, la forme contemporaine du pouvoir constituant serait le communisme en tant que “ mouvement réel qui supprime l’ordre existant ”, mouvement toujours recommencé d’une suppression sans cesse contrariée. Dans Le Capital, Marx suit le cheminement de ce pouvoir dans le conflit de classe moderne qui s’oppose, du point de vue des dominés, la séparation formelle entre producteurs et moyens de production. Pour Negri, la fusion tendancielle du social et du politique, entrevue dans les crises révolutionnaires et les déchirures de la domination, éclaire les hésitations de Lénine sur les rôles respectifs du parti et des soviets dans l’exercice concret du pouvoir constituant. Le funeste court-circuit entre l’action des masses et le commandement du parti, le compromis instable entre le pouvoir virtuel des soviets et la direction réelle du parti, résulterait pour une large part de cette confusion.
Interprétant la notion stratégiquement déterminante de “ dualité de pouvoir ”, qui caractérise chez Lénine la situation révolutionnaire, non comme un fait constitutionnel, mais comme un fait constituant, Negri tend cependant à éluder la contradiction constitutive de la démocratie politique. Non au profit d’une vérité événementielle, aussi indiscutable qu’autoritaire, mais, comme chez Badiou, par l’autodestruction d’une démocratie victime de son propre accomplissement.
Sur les traces de Machiavel, Negri fait de l’opposition entre “ vertu ” et “ fortune ”, l’énoncé fondateur de la tension dialectique entre constituant et constitué, entre le principe dynamique de la subversion et l’inertie conservatrice des institutions. Il y voit la matrice des rapports contradictoires entre la volonté et son résultat, entre la jeunesse et le vieillissement, entre la joyeuse fébrilité des départs et la lourde lassitude des fins qui s’éternisent. La “ fortune ” machiavélienne apparaît ainsi comme “ le fond maudit ” de l’inertie.
Comment la vertu pourrait-elle lui résister ?
“ Telle est la question, toujours essentielle. ”
Dans le retour récurrent des Thermidors, “ l’ennemi est une fois de plus vainqueur : la corruption, la fortune, l’accumulation capitaliste s’opposent à la virtu et la chassent. Mais la virtu, le pouvoir constituant, le grand appel de la démocratie radicale n’en avaient pas moins existé comme principe et comme espérance[8]. ” Le pouvoir constituant résiste ainsi à son institutionnalisation mortifère sous la forme de la souveraineté. Car, le contraire de la démocratie n’est pas seulement, comme l’insinue la vulgate démocratique, le totalitarisme, mais aussi la souveraineté. Tout, en effet, “ oppose pouvoir constituant et souveraineté ”. Ces deux concepts paraissent “ en contradiction absolue ”. Fidèle à l’idée de Rousseau, selon laquelle le peuple reste “ toujours maître de changer ses lois, même les meilleures ”, le refus sans-culotte de la souveraineté résume ainsi l’absoluité inaliénable du pouvoir constituant.
De façon plus inattendue, Negri oppose également le pouvoir constituant à l’utopie conçue comme affaiblissement et résiliation de son effectivité, c’est-à-dire comme “ passion triste ”. L’utopie peut en effet être considérée comme une modalité de l’espérance, définie par Spinoza comme “ une joie inconstante, née d’une chose passée ou future de l’issue de laquelle nous doutons en quelque mesure ”. Une joie douteuse donc, qui va de pair avec la crainte : pas de crainte sans espoir, et pas d’espoir sans crainte. Activité débordante et exubérante, aussi intense que l’utopie, “ mais sans illusion ou, si l’on veut, pleine de matérialité ”, le pouvoir constituant se présente ainsi comme une “ dystopie ”. Ce que confirmerait le fait remarquable que les périodes d’intense activité constituante soient aussi des périodes de déclin ou d’éclipse utopiques. Et réciproquement.
Qu’elle prenne la forme de la désobéissance ou de l’insurrection, la “ résistance à l’oppression ” est inhérente au pouvoir constituant. D’où le paradoxe logique de leur inscription dans le droit constitutionnel de 1793 : “ Le droit se construit comme principe pratique découlant du développement du pouvoir constituant. ” Cette percée du pouvoir constituant dans le droit révèle la scission en classes antagoniques du peuple mythiquement uni lors de la fête de la Fédération. Face à l’ordre nouveau du capital, qui se révèle sous le masque d’une universalité aussitôt contredite, le prolétariat s’annonce comme la nouvelle force porteuse de cette puissance toujours active et persévérante.
Dans la mesure où elle produit la médiation entre la politique et le social, dont le parti représente, dans Le Manifeste du parti communiste, la forme enfin trouvée, la Révolution française apparaît pour Marx comme la matrice de la lutte des classes moderne. Si le pouvoir constituant est un sujet, ce n’est plus celui d’une progression constitutionnelle patiente et respectueuse, mais son “ antithèse continue ”, synonyme d’un pouvoir de résistance.
Dans De la démocratie en Amérique, Tocqueville prévient son lecteur : “ Le livre que l’on va lire a été écrit sous l’impression d’une sorte de terreur religieuse produite dans l’âme de l’auteur par la vue de cette révolution irrésistible qui marche depuis tant de siècles à travers tous les obstacles et qu’on voit, encore aujourd’hui, s’avancer au milieu des ruines qu’elle a faite. ” Ce cheminement obstiné, souvent obscur, est précisément, pour Toni Negri, celui du pouvoir constituant, qui ne se délègue ni ne s’aliène. Il se manifeste et surgit dans la porte étroite d’une crise. Il est “ le concept d’une crise ”. Negri insiste, à plusieurs reprises, sur cette relation entre le pouvoir constituant et la notion de crise, sur la dialectique entre la patience processuelle et l’exaltation événementielle : “ Le paradigme du pouvoir constituant est celui d’une force qui fait irruption, qui coupe, interrompt, écartèle tout équilibre préexistant et toute possibilité de continuité. ”
Apparaît ainsi une temporalité propre au pouvoir constituant : “ une prodigieuse capacité d’accélération ”, “ un temps de l’événement où la singularité accède à la généralité ”, où le particulier s’universalise, un temps qui “ rythme, scande, et ordonne ” ses actions constitutives. Cette bousculade, cette cohue, cette précipitation d’événements, c’est la temporalité originale de la Révolution française. Une temporalité révolutionnaire, qui pose la question récurrente de savoir où commence et où finit une révolution. Le temps et l’espace spécifiques de l’événement révolutionnaire s’y manifestent comme “ un abîme de la démocratie ”, dans un moment périlleux où la radicalité constituante et sa force irruptive démystifient la scène de la représentation.
Par cette expérience extrême du pouvoir constituant, la Révolution française apparaît comme “ une révolution différente ” et “ un superbe lever de soleil ”. Plus sa temporalité indomptable se trouvera bridée par le nouvel ordre thermidorien, “ plus elle cherchera à briser ses fers et à se déployer comme mouvement de libération sociale ”. Plus elle se heurtera à la contre-révolution politique et institutionnelle, et plus elle ira puiser en profondeur les forces sociales de nouveaux élans.
Plus elle s’affirmera comme “ révolution en permanence ”.
La lutte des classes répond ainsi aux coups d’arrêt, aux blocages, et aux rebroussements, “ par des accélérations soudaines et prodigieuses ”. L’idée d’un “ temps-puissance ” naît de ces accélérations[9]. Si le peuple dispose du pouvoir permanent et irréductible de modifier sa Constitution, la temporalité ouverte et “ continuement révolutionnaire ” se découvr. comme “ fondation première de la subjectivité ”, Le “ temps des masses ” fait le pouvoir constituant . D’où le double sens attaché à la volonté, si souvent proclamée depuis Babeuf et les thermidoriens, de “ terminer la révolution ” : en la poussant jusqu’à son terme inaccessible pour les uns ; en y mettant fin une fois pour toutes, pour les autres !
Babeuf et les Egaux veulent “ terminer la révolution ” parce qu’elle n’est pas faite, ou mal faite, à moitié seulement : du travail bâclé ; l’essentiel reste à faire. Benjamin Constant ou François Furet entendent, au contraire, en finir avec elle. Au sens événementiel du terme, la révolution s’est achevée sur l’échafaud de Thermidor. Au sens de sa permanence constituante, elle reste en revanche inachevée, interrompue, interminable. Sa puissance souterraine va de cheminements invisibles en soudaines résurgences, Juin 1848, La Commune, Juin 36, Mai 68 : “ Au terme de la Révolution française, ouverture du temps veut dire révolution permanente et révolution communiste ; fermeture, veut dire libéralisme ou, pire, réaction[10]. ”
Réforme et Révolution ont chacune leurs temporalité propre. A la première, la monotonie d’un temps homogène et vide, d’une histoire sans événement, condamnée au simulacre et à l’anecdote. A la seconde, les hoquets d’un temps brisé. Décidé à conjurer le péril révolutionnaire, Edmund Burke fut le premier, sans doute, à expliciter ce rapport entre la prudence réformatrice et sa temporalité lente : “ Agir lentement et parfois même de façon imperceptible ”, suivant “ le processus lent et constant ” d’une “ énergie toujours renouvelée ”. Furtivement, sur la pointe des pieds, de crainte de réveiller le cratère de l’événement endormi. Car la dualité de pouvoir qui en surgit inévitablement n’est plus un simple maillon dans l’enchaînement mécanique des causes et des effets, mais un fait constituant qui se donne à lui-même sa propre loi.
Comment penser cette permanence paradoxale de l’événement ? Comment penser ce travail de sape qui court sous la surface apaisée des choses et se poursuit sous la chape bien ordonnée de la norme ? Comment penser cette patience affairée à élargir fissures et lézardes en brèches et fractures ? Comme une fidélité, répond Badiou. Banalement conjugale ou passionnément amoureuse, cette fidélité au passé de l’événement et de la rencontre a un parfum de piété mémorielle. Chez Negri, en revanche, le pouvoir constituant, qui “ se réalise comme révolution permanente ” ou “ qui prend figure d’un pouvoir de révolution permanente ”, est fidèle au rendez-vous et à la promesse rigoureusement immanente de libération.
Emanant de la souveraineté de la Raison, étrangère à la dialectique des temps historiques, a “ volonté générale ” dont se réclamèrent les Jacobins demeurait atemporelle comme une sorte de grâce divine laïcisée. Le concept de “ pouvoir constituant ” permet au contraire de dédramatiser celui de Révolution et de le rendre à une immanence radicale : “ Il ne doit plus être rien d’autre que désir de transformation du temps, désir continu, implacable, pratique continue et incontrôlable, réouverte par l’amour du temps[11]. ” L’affirmation initerrompue de cette puissance constitue chez Negri la grande nouveauté politique et la trame historique du XIXe siècle. Qu’en reste-t-il aujourd’hui, dans l’expérience postmoderne où l’histoire se perd dans la fugacité de l’instant.
Michael Hardt et Toni Negri abordent sans la moindre nostalgie passéiste les conséquences du passage de la modernité à la post-modernité[12]. Ils saluent cette “ transition capitale dans l’histoire contemporaine ” comme l’avènement d’une libération et comme l’opportunité d’une politique du métissage et du nomadisme, radicalement opposée aux logiques binaires et territoriales de la modernité. Prolongeant la critique de la souveraineté entreprise dans Le Pouvoir constituant, ils enregistrent sans regret le déclin des souverainetés étatiques et nationales au profit d’un Empire sans limites : alors que l’impérialisme classique signifiait l’expansion de l’Etat-Nation hors de ses frontières, il n’y aurait plus, dans l’actuelle phase impériale, d’Etats-Nations ni d’impérialisme. Ce nouveau dispositif “ supranational, mondial, total, nous l’appelons Empire[13] ”. L’Empire n’est donc pas américain, mais “ simplement capitaliste ”.
Cet Empire se serait formé à travers la concentration d’un capital transnational, la fin de la guerre froide, et les descentes de police dans le Golfe ou dans les Balkans. Il représenterait “ une nouvelle forme de pouvoir ”, une sorte de non-lieu pascalien dont le centre est partout et la circonférence nulle part. La mutation “ de l’impérialisme à l’Empire et de l’Etat-Nation à la régulation politique du marché global ” marquerait le passage, à l’échelle planétaire de la subsomption formelle à la subsomption réelle des rapports de production et de reproduction par le capital. Abolissant la frontière entre un intérieur et un extérieur, l’Empire serait désormais sans dehors.
Cette situation inédite rendrait obsolètes les préoccupations tactiques de “ la vieille école révolutionnaire ”. Elle mettrait à l’ordre du jour une contre-mondialisation, animée d’un désir immanent de libération. “ Etre républicain, aujourd’hui ”, consisterait avant tout à “ lutter à l’intérieur de l’Empire, et à construire contre lui sur des terrains hybrides et fluctuants ”. De même que les stratégies de conquête du pouvoir et de gestion économique furent isomorphes à la centralisation étatique du capital industriel, ce discours de la subversion post-moderne, en dépit de sa nouveauté proclamée, demeure lui aussi strictement isomorphe au nouvel esprit, “ fluctuant et hybride ”, du capitalisme.
Hardt et Negri affirment cependant que l’ordre impérial “ ouvre la possibilité réelle de son renversement et de nouvelles potentialités de révolution[14] ”. Le capital ayant épuisé son espace d’expansion, ses contradictions deviendraient de plus en plus insurmontables. Hardt et Negri se défendent pourtant de toute prophétie d’un effondrement fatal du système. Ils se demandent comment les résistances et les actions de la multitude peuvent “ devenir politiques ”. Bien qu’elle soit claire sur le plan du concept, admettent-ils, “ cette tâche de la multitude reste plutôt abstraite ”. Quelles pratiques concrètes vont animer ce projet politique ? “ On ne peut le dire pour le moment[15]. ”
Aucune prescription doctrinaire ne peut, en effet, remplacer l’accumulation de nouvelles expériences fondatrices. Nulle transcendance programmatique ne peut se substituer à l’inventivité immanente de la lutte. Mais nulle profession de foi, fût-elle accompagnée de mille trompettes, ne saurait non plus ébranler les murs invisibles de l’Empire.
Empire représente un effort remarquable pour penser synthétiquement la nouveauté de l’époque et pour tirer parti de la critique post-moderne des Lumières. Au lieu de camper sur la ligne Maginot de nation ou de se réfugier confortablement dans le mythe des révolutions passées, ses auteurs soulignent qu’il ne saurait y avoir de marché global sans qu’émerge un ordonnancement juridique supra-national. Empruntant à Foucault le thème de la biopolitique et du biopouvoir, ils explorent les conséquences de l’extension des rapports marchands à toutes les sphères de la reproduction sociale. Leur faiblesse vient, en revanche, de ce qu’ils ne soumettent guère leurs hypothèses à l’épreuve des réalités concrètes de la concentration du capital, de la géopolitique et des stratégies militaires, du lien effectif entre les entreprises transnationales et les appareils étatiques. Ils cèdent à l’illusion chronologique qui consiste à concevoir modernité et post-modernité comme des époques successives et non comme deux logiques culturelles complémentaires et contradictoires de l’accumulation du capital : centralisation d’un côté, fragmentation de l’autre ; cristallisation du pouvoir, et dissolution généralisée ; pétrification des fétiches, et fluidité de la circulation marchande.
La séparation dans le temps de ces tendances jumelles, fait apparaître le nouvel ordre impérial comme “ post-moderne ”, “ post-colonial ” et “ post-national ”. Elle renforce l’illusion de “ l’après ”. En réalité, l’Empire ne supprime pas l’ancien ordre des dominations inter-étatiques. Il s’y superpose. L’ébauche d’un nouvel ordre juridique supranational demeure lié à l’ordre ancien des Etats. Si l’Empire est plus multipolaire et multicéphale qu’exclusivement américain, il n’en organise pas moins une hiérarchie de dominations et de dépendances entre nations. Le capital et les firmes se transnationalisent, mais elles continuent à s’adosser à la puissance militaire, monétaire et commerciale des Etats dominants. En tirant des conclusions extrapolées de tendances encore contradictoires, la formule de “ L’Empire, stade suprême de l’impérialisme ” court le même risque que celle de Lénine sur l’impérialisme comme “ stade suprême du capitalisme ” : celui d’une interprétation catastrophiste pour laquelle le “ stade suprême ” devient un stade terminal, sans issue aucune.
A la suite de Machiavel et de Spinoza, Hardt et Negri définissent la politique comme mouvement de la multitude. Malgré “ le déclin des sphères traditionnelles de résistance ” et bien que “ les espaces publics soient de plus en plus privatisés ”, la politique, contrairement à ce que redoutait Hannah Arendt, ne serait pas menacée de disparition. Elle perdrait seulement son autonomie illusoire pour se confondre avec la lutte sociale : “ Les conflits sociaux qui constituent le politique se traitent désormais directement, sans médiation d’aucune sorte ”. Si la politique est un art des médiations, qu’en reste-t-il lorsqu’on supprime les médiations ? La fusion décrétée du politique et du social escamote la difficulté plutôt qu’elle ne la résout. Conclure, sans plus de précisions, que le mouvement de la multitude aura à “ inventer les formes démocratiques d’un nouveau pouvoir constituant ”, trace une perspective trop vague face aux défis de l’époque.
Pour conjurer les effets de la réification et de l’aliénation marchandes, on ne saurait, en effet se contenter de formules opposant la multitude au peuple, le jaillissement insaisissable du désir à l’emprise du pouvoir, les flux déterritorialisés au quadrillage des frontières, la reproduction bio-politique à la production économique. Hardt et Negri savent fort bien – et le disent – que la mercatique, “ postmoderne avant la lettre ”, peut investir la pluralité et transformer “ chaque différence en opportunité ” de consommation, ou “ la gestion de la diversité ” en opération lucrative. Ils savent – et le disent – que l’apologie de contre-pouvoir locaux et des actions “ de proximité ” peut fort bien exprimer une impuissance face au pouvoir tout court. Ils savent aussi que “ l’hybridation, la mobilité et la différence ne sont pas libératrices en elles-mêmes ” et qu’on ne saurait, sans avoir à en payer le prix fort, renoncer à quelque visée de vérité.
Il ne suffit pas davantage d’opposer au “ peuple ” mythique, “ qui est une synthèse instituée préparée pour la souveraineté ” tendant à l’homogène et à l’identique, une multitude faite d’individualités et de multiplicités irréductibles. ”. Dans la post-modernité, le “ subjugué soumis ” aurait “ ”absorbé l’exploité ” et la “ multitude des pauvres gens ” aurait “ avalé et digéré la multitude prolétarienne ”[16]. Ce pari sur la multitude flirte de manière paradoxale avec une représentation populiste, faisant du pauvre “ le fondement de la multitude ” et “ aussi le fondement de toute possibilité d’humanité ”.
“ Par où commencer ”, demandait jadis Lénine, au seuil d’une nouvelle époque ? “ Le seul événement que l’on attend toujours, répondent aujourd’hui Hardt et Negri, est la construction d’une puissante organisation révolutionnaire ”, mais “ nous n’avons pas de modèle à proposer pour cet événement ”[17]. A défaut, leur livre s’achève sur un devoir militant aux allures d’impératif catégorique : “ Aujourd’hui, après tant de victoires capitalistes, après que les espoirs socialistes se sont dissous dans la désillusion, et après que la violence capitaliste contre le travail s’est cristallisée sous le nom d’ultra-libéralisme, comment se fait-il que le militantisme existe toujours ? ” S’inscrivant dans le divorce maintenu entre l’immédiateté des résistances et l’espoir d’un événement incertain, la proclamation selon laquelle “ le militantisme contemporain ” fait “ de la rébellion un projet d’amour ”, prend l’accent d’une profession de foi.
Il n’est guère surprenant que la figure destinée à “ éclairer la vie future du militantisme communiste ” soit alors celle de François d’Assise, le Poverello résistant au capitalisme naissant : “ Dans la post-modernité, nous nous retrouvons dans la situation de Saint François opposant à la misère du pouvoir la joie de l’être. C’est une révolution qu’aucun pouvoir ne contrôlera – parce que le bio-pouvoir et le communisme restent ensemble, en tout amour, toute simplicité et toute innocence. Telles sont l’irrépressible clarté et l’irrépressible joie d’être communiste[18] ”. La joie expansive du Saint François selon Negri répond ainsi à l’austère exigence du Saint Paul selon Badiou. Dans les deux cas, la politique révolutionnaire introuvable tend à se muer en étrange mystique sans transcendance.
[1] Philippe Raynaud, Les nouvelles radicalités, Notes de la Fondation Saint-Simon, avril-mai 1999.
[2] Antonio Negri, Le Pouvoir constituant, Paris, Puf, 1997.
[3] Gilles Deleuze, Spinoza, Philosophie pratique, Paris, Minuit, 1981, p. 134.
[4] Antonio Negri, op. cit., p. 428.
[5] Carl Schmitt rappelle à ce propos que la dictature, en tant que pouvoir d’exception opposé à l’arbitraire de la tyrannie ou du despotisme, a longtemps été conçue comme un “ miracle ”, dans la mesure où elle suspend la légalité étatique comme le miracle suspend la légalité naturelle.
[6] Ibid., p. 331 et 436.
[7] Cette tentation est liée au rapport, souligné par Carl Schmitt, entre la notion moderne de pouvoir constituant, radicalement immanent, et le passage de la “ dictature commissaire ” (pouvoir d’exception légalement délégué par mandat pour une durée déterminée) à la “ dictature souveraine ”, dont le pouvoir n’est “ obligé par rien ” : “ Alors que la dictature commissaire est autorisée par un organe constitué et à un titre de la constitution en vigueur, la dictature souveraine ne dérive que, et immédiatement, du pouvoir constituant informe ” (Carl Schmitt, La Dictature, Paris, Seuil, 2000).
[8] Ibid., p. 190.
[9] L’accélération des rotations du capital, de la circulation des marchandises et de la diffusion de l’information peut-elle prendre désormais de vitesse cette temporalité révolutionnaire ?
[10] Ibid., p. 308.
[11] Ibid., p. 438.
[12] Michael Hardt et Toni Negri, Empire, Paris, Editions Exils, 2000. Ce livre constitue un important effort de synthèse, abordant des questions philosophiques et stratégiques, aussi bien qu’historiques et économiques. Nous aurons à y revenir ailleurs que dans ce bref essai.
[13] Toni Negri, “ L’Empire, stade suprême de l’impérialisme ”. Le Monde Diplomatique, janvier 2001.
[14] Ibid. p. 393 révolutionnaire plus grand que ne l’ont fait les régimes modernes de pouvoir ” (p. 474).
[15] Ibid., p. 480
[16] Ibid., p. 204.
[17] Ibid. p. 493.
[18] Ibid. p. 496.
©EspaiMarx 2002